10 juillet
Ma pile à lire s’est enrichie ces dernières semaines de trois essais dont les titres contenaient le mot « vieille », un hasard alors que je me sens parfois, souvent même, complètement en décalage avec ce que devraient être mes presque 40 ans ? Pas sûre non.
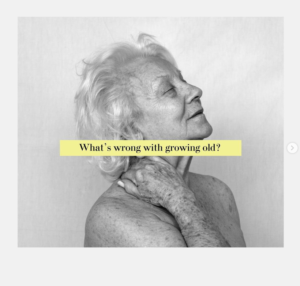
Vieille fille, une proposition de Marie Cock m’a été suggérée par Johanna Cincinatis, journaliste et essayiste qui travaille sur l’amitié entre personnes minorisées, rencontrée lors d’une résidence d’écriture/yoga (la vraie vie dont je rêve) chez Camille Teste (elle aussi écrit : elle est à l’origine d’un essai sur la politisation du bien-être, Politiser lebien-être). J’avais précommandé Vieille peau, les femmes, leurs corps, leur âge de Fiona Schmidt publiée aux éditions Belfond, je la suis sur les réseaux (pouloulou), j’apprécie ses analyses de l’actualité et ses positionnements, j’avais eu l’occasion de publier un article dans une même revue (Etonnantes n°5). Et en passant déposer quelques exemplaires du fanzine du Caen Féministe Camp à Aline, de la librairie Le Brouillon de Culture, je suis tombée sur L’été où je suis devenue vieille d’Isabelle de Courtivron.
Je vous propose donc une recension croisée de ces trois lectures*.

Celui d’Isabelle de Courtivron n’a pas répondu à mon horizon d’attente, exigeant et précis, c’est vrai. Il s’agit bien d’une prise de conscience mais plutôt celle d’un décalage culturel avec la génération qui succède à l’autrice et comment elle compose avec ses succès féministes des années 70 et le présent vibrant. Ce n’est pas un essai documenté mais plutôt une approche subjective et individuelle, c’est en fait une autobiographie, un regard porté vers ce qui a précédent le présent d’écriture.
Dans Vieille peau, les femmes, leurs corps, leur âge, Fiona Schmidt analyse les enjeux genrés de la vieillesse, de ce qui est considéré comme la vieillesse des f*mmes, à partir des doubles standards et des injonctions patriarcales.
Elle met ainsi en lumière l’âgisme latent en précisant que « La vieillesse est à ce point déconsidérée que la plupart du temps, les comportements et discours à l’égard des personnes âgées ne sont pas identifiés comme tels. » (p. 15). Fiona Schmidt fait le lien entre l’âgisme et le patriarcat par les violences subies dans le care. Elle écrit que la vieillesse est :
« […] une accumulation de violences, qui ne se limitent pas à celles qui font la une des médias, et sont d’autant plus pernicieuses qu’on les alimente en détournant le regard. Les violences subies par nos aîné·es et celles qui s’en occupent, à tous les niveaux, sont l’écho amplifié des violences de genre qui sévissent dans notre société. » (p. 248)
Ce sont en effet les f*mmes qui prennent en charge leurs époux (puisqu’ils sont généralement plus âgés qu’elles et qu’elles vivent plus longtemps), leurs parents et les accompagnent dans leurs fins de vie. L’autrice se réfère souvent à La vieillesse de Simone de Beauvoir comme à ses propres observations pour réfléchir à l’enjeu féministe du care et de la vieillesse :
« J’ai vu les femmes de ma famille surveiller le moindre mouvement de ‘leurs’ vieux et klaxonner ‘Attention !’ s’ils grimpaient un escalier, mangeaient trop de sucre ou s’approchaient d’un angle. Exactement comme elles le faisaient avec leurs enfants. J’ai vu les hommes alors qu’ils prêtaient la même oreille distraite aux conversation des vieux, les interrompant comme ils nous interrompaient nous, les enfants, sans même avoir pris conscience de le faire, simplement parce que la parole des êtres humains aux deux extrémités du spectre de l’existence (et de la table et de la salle à manger) avait moins de consistance que celle des autres » (p. 25)
Les violences subies par les ancien·nes seraient aussi le fruit d’une logique imparable : « Les maltraitances sur les personnes âgées augmentent parce que le nombre de personnes âgées augmente, et parce que parmi elles, la plupart sont des femmes » (p. 251) – puisque les f*mmes vivent plus longtemps que les h*mmes.
Cette déconsidération des vieilles f*mmes est construite par les normes de la féminité qui ne promeuvent qu’une jeunesse vulnérable. Fiona Schmidt s’arrête sur la représentation des femmes dans les fictions filmées : les femmes de 40 ans jouent les mères des acteurs de 40 ans… Angelina Jolie, 30 ans, joue la mère d’Alexandre le Grand, incarné par Colin Farell, qui a… 30 ans, ou Carey Mulligan qui joue une femme de 56 ans dans The Dig. « Autrement dit, une femme de 35 ans et une femme de 56 ans, dans cette part de l’inconscient collectif qui ne s’est pas mis à jour depuis 1762, appartiennent à la même catégorie indifférenciée des ‘femmes mûres' » (p. 84). Elle relève aussi les écarts d’âge classique dans les couples représentés par la fiction. L’homme est toujours de 10 à 15 ans l’aînée de sa conjointe sans que cela ne soit jamais questionné, l’inverse est un sujet, politique même. L’autrice prend l’exemple de la différence de traitement médiatique des écarts d’âge dans les couples Trump et Macron, 24 ans séparant les conjoint·es, mais un seul en a subi de la disqualification et des caricatures, celui dont la femme est plus âgée.
Il faut dire que les femmes subissent une féminité balisée dans leur temps de vie, c’est les menstruations qui les caractérisent de femmes : de petite fille, on est perçue comme femme dès lors que l’on est menstruée, la ménopause, elle fait sortir du rang. Et celles qui rendraient visibles les signes de changements hormonaux, changement d’humeur, douleurs menstruels, sécheresse vaginale, bouffées de chaleur sont rendues « folles » par le discours médical, parce que non disponibles sexuellement pour leurs époux**.
Bien vieillir « impose un modèle normatif, conclut Fiona Schmidt, qui est en réalité une injonction contradictoire : selon les auteurs, ‘bien vieillir’ consiste en fait à ne pas vieillir, donc à rester jeune, ce qui revient à dénigrer la vieillesse. » (p. 258)
Il est moins question d’âge que de célibat dans Vieille fille, une proposition, dans lequel il s’agit de faire sécession avec le couple en ce qu’il serait une entité mythologique, l’unique chemin d’épanouissement, d’accomplissement, du bonheur, le sens de la vie quoi.
Le lien que je dresse entre ces deux lectures est la question posée tôt dans l’essai : « De qui la vieille fille est-elle la Némésis ? De la jeune fille. » (p. 57)
La vieille fille, celle qui décide de ne pas prendre époux, de ne pas se plier aux sacrifices exigeants du mariage, ne devient pas femme, non pas qu’elle ne saigne pas de ses menstrues mais qu’elle n’est ni épouse, ni mère, insoumise donc à la loi faisant de son utérus le foyer du couple et de la famille. Je crois, dans la continuité de la question de Marie Kock, que la vieille fille est la Némésis de la jeune femme, celle qui n’a pas le luxe d’attendre de choisir son destin amoureux, conjugal, familial.
L’accomplissement féminin est considéré ici par le couple et s’y soustraire et ne pas courir après fait sortir du rang des femmes.
« Mais que deviennent celles qui n’ont pas envie de coller à un idéal esthétique ? Qui se fichent d’être désirables ? Ou alors qui sont dans une forme de soin de soi qui ne vise pas la séduction du sexe opposé ? Que fait-on de ces irrécupérables ? Rien » (p. 45)
Marie Kock rappelle l’angle mort du couple, la dissolution de l’individualité et de l’épanouissement serein : « Le couple, la famille, c’est un peu comme Paris. Parce qu’il faut bien y vivre une fois qu’on a choisi de s’y installer, même si c’est au-dessus de nos moyens et que l’on se met à confondre ce qui est primordial et ce qui est accessoire » (p. 112) et d’ajouter : « Il existe une valeur couple comme il existe une valeur travail. Et, à l’époque du libéralisme, nous avons intégré l’idée qu’il fallait que cela soit dur pour que cela ait de la valeur, que cela demandait des sacrifices et que nous devions être prêts à les faire. » (p. 133)
En évoquant sa solitude choisie, Marie Kock repense les bornes de la relation affective. Citant Voltairine de Cleyre, elle chérit la distance et envisage le couple comme une forme de tremplin à partir duquel virevolter : « Et si les fondations d’une relation ne servent pas à l’expression d’une liberté de mouvement et de transformation, est-ce qu’on ne se serait pas trompé sur le bâtiment qu’on croyait construire ? » (p. 75-76). La sexualité, présentée comme la pierre angulaire d’une relation romantique en ce qu’elle différencierait une relation amicale d’une relation amoureuse*** est bien sûr en travail ici : « Comment désirer sans subir une relation de pouvoir mais aussi comment désirer sans l’exercer soi-même ? » (p. 175) Il s’agit de retrouver de l’autonomie et du plaisir dans le corps comme précisé par l’autrice : « Le yoga, la danse, les massages, les câlins sans ambiguïté ont été autant d’apprentissages qu’une vie corporelle riche était possible, même sans la sacro-sainte glorification de la relations sexuelle comme physicalité ultime. »(p. 181). Cette partie m’a beaucoup fait penser au dernier essai d’Ovidie, La chair est triste hélas, sur lequel je pense écrire dans quelques temps.
J’ai apprécié les références sur la représentation des célibataires : Spinster, les béguines (voir le roman La Nuit des Béguines d’Alice Kiner) le polar de Fred Vargas Quand sort la recluse et Herland de Charlotte Perkins Gilman. Pour plus de références, Zoé, de la Nouvelle Librairie Guillaume de Caen, a mis en avant quelques titres en cohérence avec le présent article.

Dans Vieille fille, j’ai souri en lisant la référence à celle que j’adore depuis ma thèse, Delphine de Girardin et ses Contes d’une vieille fille à ses neveux dans lesquels elle outille ses neveux pour qu’ils naviguent avec les injonctions des codes de cour sans avoir s’y soumettre, la facétieuse Delphine, objet d’un premier chapitre d’un nouveau projet collectif avec la non moins merveilleuse Elise Kasztelan.
Si tu lis cet article Marie, je comprends complètement ton engouement pour Scrabble Go, j’ai trouvé plus doux : Word Master !
Ce sont trois ouvrages très différents, abordant la question des normes patriarcales depuis des endroits distincts, l’âge, le couple. Leurs lectures sont fluides, abordables, questionnent chacun·e sur son propre rapport aux identités de genre et aux doubles standards qu’on leur applique. J’ai eu la sensation qu’il y était peu question des personnes trans et non-binaires et des personnes non hétérosexuelles. J’aimerais beaucoup lire des articles et/ou des essais sur les vieillesses trans, l’arrêt des menstrues, les traitements et le changements hormonaux, les couples lesbiens et la ménopause. Les adelphes qui me liront, si vous avez des références et l’énergie patiente de les transmettre, je prends!
* Mes notes de lectures ont été prises avec la méthode d’index de Nathalie Sejean, c’est une première et c’était bien. J’ai trouvé que c’était plus simple d’aller repiocher ce que j’avais souligné. Avant, je cornais les pages, je devais relire toute la page pour retrouver ce qui m’avait interpellé. Je note seulement que je dois améliorer ma catégorisation parce qu’entre le point d’exclamation et le coeur en marge et en index, des fois, c’est confus.

**Écouter le cycle d’émissions de Pauline Chanu « Les fantômes de l’hystérie – Histoire d’une parole confisquée » dans La Série documentaire sur France culture
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-les-fantomes-de-l-hysterie-histoire-d-une-parole-confisquee
*** Question qui circule depuis des années à laquelle des brochures, des discussions enflammées tentent de répondre sans faire consensus : où est la frontière entre l’amitié et l’amour ? A bas les frontières, toutes. Dans ce cas, qu’est-ce que la sexualité ? quelle place occupe-t-elle dans une relation ? Et quand commence la sexualité dans une pratique sensuelle ?
Je fais un tout petit commentaire en tout petit caractère parce que c’est une critique relevant sûrement d’une vision étriquée de la syntaxe : je ne comprends pas pourquoi les essais que je lis ces derniers mois se laissent aller à un usage de la phrase complexe complètement décadent, oui, décadent, je vais jusque-là. Et vas-y des phrases sans verbe censément associées à la proposition grammaticale précédente.
Par exemple :
– « En tant que future aidante, qui sera amenée à fournir à son tour, auprès de sa mère comme à son conjoint de quinze ans son aîné, un travail non reconnu ni rémunéré comme tel car sublimé en une forme d’amour filial et conjugal.
En tant que future citoyenne âgée et potentiellement dépendante. «
Pas de proposition principale, pas de verbe principal.
– « J’ai et j’aurai une vie normale, banale, ordinaire. Mais dont j’ai choisi le plus possible les termes que que je ne pourrai reprocher à personne. Une vie dans laquelle je peux être ma propre guide et gardienne ». Le sens est excellent (j’ai mis un coeur en marge), mais pourquoi faire trois phrases ici quand une seule, ponctuée, aurait permis une unité entre la forme et le sens ?